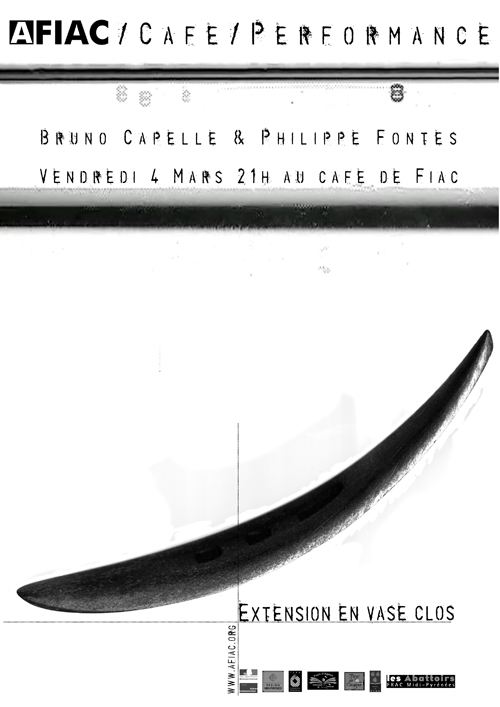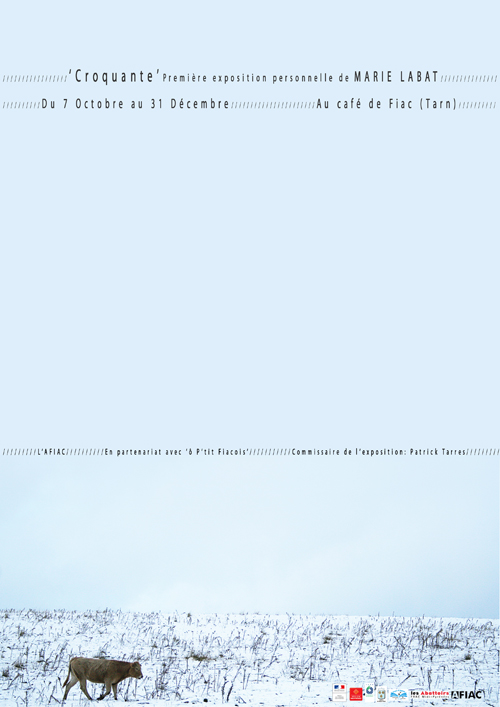Le 7 janvier 2011 au café de Fiac 21h

« Si « la foule c’est le mensonge », alors, à l’instar de Diogène qui cherchait, muni d’une lanterne, un homme en plein jour, les performeurs nous interpellent invariablement en tant qu’homme et seulement en tant qu’homme. » Jean-Luc Lupieri
Répondant à une petite annonce d’habilleuse pour music-hall, je me suis récemment trouvé par hasard dans les coulisses d’une revue Toulousaine. Je crois avoir été bouleversé en tant que femme, par ces donneurs et donneuses de rêve. Pour répondre à la question qui sont ces danseuses de revue ? Dévoiler les trucs et les ficelles qui font de ces corps, que la société aime imberbes, des déesses de notre société de consommation, un corps sans faille mais tellement fragile. L’hommage à Guy Debord : Plus que de les mettre à jour dans une action performative, il s’agit aussi de mettre en lien l’intime et les masses médias :l’individu, seul devant son miroir, se préparant pour aller, travailler, sortir, s’adapter, se conformer au monde induit par le pouvoir des masses médias, et l’économie elle-même. Edwige Mandrou
Traces | Vidéo
Notre point de départ n’est certes pas de rendre compte par des mots ou des concepts appropriés d’une réalité dont toute trace, à vrai dire – qu’elle soit écrite ou filmée –, demeure, par essence, éloignée de ce qui fut vécu et éprouvé au moment même de son exécution. De fait, ce que nous pourrons dire de cette performance qui, je crois, a constitué un des moments forts du festival Live Action de Göteborg, doit être entendu comme un témoignage de reconnaissance vis-à-vis d’une œuvre qui, comme tout hapax, se perpétue seulement à travers l’empreinte occasionnée chez ceux qui y participèrent.
Ceci étant dit et avant de pénétrer au cœur même de l’action, nous allons, en guise de jalon, opérer un bref détour sur l’intitulé de la performance car, après tout, que peut bien signifier aujourd’hui un hommage à Guy Debord ? Pour faire court, lorsqu’on se réfère à Guy Debord, c’est le plus souvent en référence à La société du spectacle. Cet ouvrage, dont la lecture n’est guère facilitée par une terminologie s’avérant parfois très hermétique, constitue une critique radicale du capitalisme dont le stade achevé est, selon l’auteur, celui du spectacle. En fait, derrière le spectacle se cache en réalité le règne de la marchandise et de sa fétichisation éhontée dans une société dont la consommation exponentielle représente toute l’essence : « Le monde à la fois présent et absent que le spectacle fait voir est le monde de la marchandise dominant tout ce qui est vécu. » Partant de là, on sait que le film homonyme réalisé par Guy Debord en 1973 est construit autour du principe d’un détournement systématique des images. Ce détournement vise à accomplir une inversion de l’illusion initiale afin de rétablir la vérité du mensonge dont les images sont les véhicules. Si hommage il y a, c’est donc qu’Edwige Mandrou s’inscrit à la fois dans la continuité situationniste de cette critique du fétichisme de la marchandise, mais aussi, qu’elle en utilise explicitement les armes.
Pour le premier point, la pratique même de la performance constitue un positionnement radical contre la production de marchandises – fussent-elles malencontreusement des œuvres d’art. Je renvoie ici le lecteur aux analyses de Karel Teige qui dévoile dans quelle mesure le capital s’est approprié le monde de l’art et comment ce dernier sert désormais, avec parfois beaucoup d’obséquiosité, les desseins de son maître. Si la performance s’avère improductive en termes d’objet c’est bien que les performeurs refusent de participer au circuit dominant de la production, de l’accumulation, bref du fétichisme de l’objet d’art. Cela relève d’un engagement aussi bien politique qu’esthétique, car si la sphère de la marchandise s’entend comme une négation de la vie, alors la négation de la marchandise retrouve le sens même d’une résurgence de la vie – c’est-à-dire remet à l’endroit ce qui se trouvait inversé. L’action performative est donc une praxis hostile aux injonctions productivistes d’un marché visant l’accumulation du capital-art. Elle se comprend de ce fait comme une praxis cherchant à se désaliéner d’un art devenu prisonnier des formes totalitaires d’expression promues par le capitalisme achevé dont l’apparence relève du spectaculaire. La performance est donc, dans sa forme et dans son fond, négation du spectacle. Aussi, l’utilisation des images dans la performance n’a d’autre finalité que de renverser l’ordre dominant du spectaculaire pour y inscrire la vie dans ce qu’elle a de plus palpitant et d’effectivement présent.
Concernant le deuxième point, on est en droit de s’attendre, de la part de l’artiste, à un usage du détournement comme mode opératoire d’expression. Car si, comme l’affirme Debord : « le détournement est le langage fluide de l’anti-idéologie », alors, nous trouverons, dans le type de dispositif mis en oeuvre, des éléments exploitant ce procédé. Il semble bien que cela soit le cas puisque dès l’entrée en matière de cette performance nous sommes subitement confrontés à une succession d’images dont le caractère détournées apparait évident. A l’instar du film de Debord, il convient de comprendre cette technique du détournement comme l’énoncé d’une vérité qui advient dans sa présence même et non comme une vérité des images utilisées : « Le détournement n’a fondé sa cause sur rien d’extérieur à sa propre vérité comme critique présente. » Autrement dit, ce qui compte au premier chef, ce n’est pas la pertinence des images elles-mêmes mais la perspective artistique de leur détournement. Bien entendu, les images projetées ne sont ni anodines ni indifférentes, pas plus que l’ordre de leur succession dans le déroulement de la performance ou la violence sporadique de leur contenu. Le seul fait d’utiliser plusieurs scènes d’émeutes – s’étant déroulées sur les lieux mêmes (Göteborg) – fortement réprimées par les forces de l’ordre n’est certes pas sans signification. Pourtant, les images de la violence ne sont pas la violence réelle. Si l’on veut, ces images ne sont que la mise en œuvre édifiante de la violence spectaculaire qu’il s’agit au fond de critiquer. Car ce qui se passe, se passe toujours hic et nunc, ici et maintenant, alors que l’image, comme le notait déjà Platon, n’est qu’une copie mensongère, une simple idole (ειδωλον).
Afin de pouvoir se représenter un peu mieux le déroulement de cette performance, il convient d’éclaircir le dispositif performatif élaboré par l’artiste. Le public, plongé dans une pénombre faiblement éclairée par quelques sources lumineuses, fait face à un écran. A droite de celui-ci et à proximité du public, Edwige est assise à une table sur laquelle un ordinateur (source des images qui se déploient sur l’écran) est ouvert. Face à elle – c’est-à-dire à gauche de l’écran – se tient Peter Rosvik, debout, pour l’instant immobile, éclusant en silence des canettes de bière.
Après le générique de la Metro Goldwyn Mayer, la performance s’engage sur un cortège de clichés concernant l’Amérique. Ce défilé, d’abord lent, s’anime progressivement jusqu’à atteindre un paroxysme – tant dans la multiplication affolante des objets produits en série que dans le vertige d’une architecture de la démesure. Le ton est donné, l’image dupliquée à l’infini, l’image manipulée nerveusement et à la hâte, l’image reproduite jusqu’à l’écœurement, soulignée par une musique ad hoc, nous donne le vertige. Cependant, alors que ce flux emblématique défile, le visage d’Edwige s’incruste ex abrupto sur l’écran. Ce visage qui, sous les effets du logiciel Photo Booth, se morcelle au point de provoquer une impression de dédoublement, n’est pas sans susciter une inquiétante étrangeté. Quid de cette représentation du visage de l’artiste ? Le fait qu’Edwige projette simultanément son image dédoublée sur l’écran, occasionne en réalité un trouble sur ce que nous sommes à même de devoir regarder. Que voyons-nous en définitive : elle, dans sa présence effective devant nous ? Ou bien : elle, en tant qu’image illusoire, déformée – mais par là même fascinante ? Cette mise en abyme de soi par le truchement de ce jeu spéculaire jette d’emblée un discrédit sur l’incroyable fascination que peuvent produire les images, qui, par delà leur dimension mensongère se révèlent ici fondamentalement équivoques et suspectes.
Ce dispositif va se poursuivre tout au long d’une action de maquillage. En effet, nous assistons à la transformation progressive d’Edwige en « reine de la nuit ». Utilisant sa webcam comme un miroir, elle va, avec tout le soin nécessaire, grimer son visage avec les artefacts inhérents aux danseuses de cabaret : faux-cils, fards, rouge à lèvres, eyeliner, etc. Durant tout ce temps, Peter continue à boire tandis que les images se succèdent sur l’écran de façon ininterrompue. Cette modification graduelle du visage se prolonge par le troc des vêtements de ville pour un string noir accompagné d’un soutien-gorge assorti et de chaussures à talons hauts. Alors que la musique aux relents mystico-héroiques d’Enya s’impose, Edwige Mandrou s’empare d’un épilateur et s’arrache une partie des poils pubiens devant sa webcam, engendrant un effet kaléidoscopique aussi saugrenu qu’énigmatique sur l’écran. Enfin, la métamorphose atteint son comble lorsque la performeuse se pare du harnachement – composé de plumes d’autruche – spécifique à ces danseuses et se met, avec frénésie, à se trémousser de façon mi-cathartique mi-hypnotique.
La singularité d’un tel événement a de quoi surprendre, mais, si on garde en mémoire le fil conducteur initié par le propos, il est possible d’y déceler la dichotomie dénoncée par Guy Debord : Alors que le spectaculaire hégémonique et hypnotique défile, l’être aliéné qui y participe et le nourrit de sa substance, en est évincé. Pour lui, seule la réalité prosaïque fait loi, le réel avec son ordre, sa temporalité, sa misère et sa banalité. Ces filles, grimées de leurs apparats, vouées corps et âme à la société du spectacle, évoquent manifestement notre propre aliénation. En ce sens, ces « donneuses de rêves » ne doivent pas être entendues dans leur littéralité mais comme métaphore de notre situation. A la solde d’un « tyran » que nous nourrissons et entretenons de notre labeur, nos « gesticulations » – aussi vaines que ridicules – figurent le pathétique de la situation. Certains « dansent » jusqu’à l’inconscience pour s’étourdir et ne pas sentir le poids de leurs propres chaînes. D’autres, à l’image de ce qu’illustre Peter Rosvik – apathique, hagard, bazardant méthodiquement les canettes de bière après s’en être abreuvé, se grisent d’images et d’alcool. Entre divertissement et abrutissement, le choix semble cornélien. « Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n’exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. »
Désormais, nous pouvons entendre l’intitulé de la performance : la politique de l’autruche. Après s’être fougueusement déhanchée sur des rythmes endiablés composés sur la base de percussions, Edwige sort d’un sac des modèles réduits de voitures et d’hélicoptères de police – jouets bruyants et virevoltants qu’elle remonte et dépose au sol.
Dans ce tintamarre assourdissant où retentissent les sirènes, Peter, enfin actif, l’aide à insérer sa tête dans un seau qui sera entièrement rempli de sable, devenant, par ce fait, un agent efficient de l’aveuglement. Seul un tuyau permet encore à Edwige de respirer. Toujours affublée de ses plumes d’autruche, l’artiste, penchée en avant, jambes écartées, nous impose, du coup, la vue de son postérieur. Par cette posture, mimant au pied de la lettre l’attitude supposée des autruches qui, face à un danger, enfouiraient leur tête dans le sable, elle rappelle notre tendance à masquer notre regard pour vainement tenter d’échapper à des situations difficiles mais bien réelles. Belle allusion ironique de ce qui se passe effectivement dans le monde car, si nous absorbons quantité pléthorique d’images, celles-ci font le plus souvent écran à l’existence réelle. Nous regardons, subjugués, et nous croyons voir. Or, ce que nous voyons n’est que l’ombre fantomatique de nos propres vies dépossédées de leur substance vitale.
Alors qu’elle a la tête dans le seau, Peter déambule au milieu du public en offrant, à qui le souhaite, des parts prédécoupées d’un large fromage sur lesquelles sont fichés de petits drapeaux nationaux. Les parts inégales furent au préalable établies en référence au rang de classement déterminé par le PIB de chacun des pays mentionnés. De fait, pendant que l’assistance se partage symboliquement le monde, sous les rugissements irritants des sirènes policières, Edwige Mandrou ne voit et n’entend rien, totalement absente à ce qui l’entoure. Il faudra attendre qu’elle retire, groggy, sa tête du sable pour l’entendre énumérer les noms des pays les plus pauvres restant » bizarrement » sur le plateau, avant de les jeter à la poubelle, tels des miettes.
Ainsi s’achève cette performance mémorable qui a, à proprement parler, abasourdi un public médusé et pratiquement KO – ou pour le moins, sonné – au point de ne plus savoir s’il convenait d’applaudir ou de préserver le silence bienvenu résultant de l’arrêt des sirènes.
Constituant la dernière performance de la soirée, elle fut en tout point édifiante de ce que peut être la pratique de l’art-performance – entendu ici comme la négation active du spectaculaire par l’entremise d’une action modifiant authentiquement notre rapport à la réalité. Un tel événement n’a pas grand-chose à voir avec les formes classiques de dramatisation spectaculaire. Ce que nous vivons, à travers la performance, relève entièrement de l’expérience singulière de notre propre vie, dans une temporalité qui n’est pas de l’ordre de la captation ou du divertissement, mais bien de l’ordre du temps éprouvé, du temps vécu. Si, comme le pense Debord, « le spectacle réunit le séparé, mais (qu’il) le réunit en tant que séparé », l’action performative sépare le « réuni » (le collectif) pour produire du « séparé » (de l’individuel). Ce n’est pas en tant que public que nous sommes convoqués, mais en tant qu’individu existant par un autre individu lui-même existant et non pas, comme c’est le cas dans les spectacles, par un personnage quelconque ou le représentant abstrait de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Si « la foule c’est le mensonge », alors, à l’instar de Diogène qui cherchait, muni d’une lanterne, un homme en plein jour, les performeurs nous interpellent invariablement en tant qu’homme et seulement en tant qu’homme. Cette lutte perpétuelle pour rester debout n’est pas neuve, mais il semble qu’aujourd’hui le monde de l’art-performance en soit le héraut salutaire. « Ce que le spectacle a pris à la réalité, il faut le lui reprendre. Les expropriateurs spectaculaires doivent être à leur tour expropriés. Le monde est déjà filmé. Il s’agit maintenant de le transformer. »
Jean-Luc Lupieri, Janvier 2009